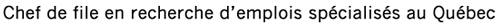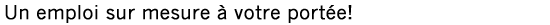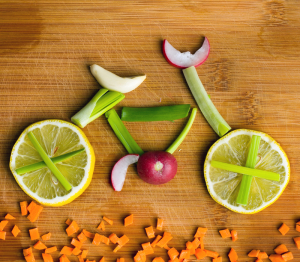Coût en construction 2025 : pressions croissantes sur le Québec public

Partagez sur les réseaux sociaux
Le 26 juin 2025
Depuis cinq ans, les coûts de construction augmentent de façon constante au Canada. Mais en 2025, la situation appelle à plus qu’une simple vigilance, surtout au Québec. D’après le rapport Verisk Q1 2025, les coûts de reconstruction résidentielle ont bondi de 29,1 % à l’échelle nationale en 5 ans et de 13,6 % sur les trois dernières années. Le Québec suit une trajectoire semblable, avec une hausse moyenne de 12,9 % depuis 2022.
Ces augmentations touchent directement les villes, les commissions scolaires, les réseaux de santé et les sociétés publiques. Et pourtant, dans plusieurs cas, les budgets sont encore basés sur des évaluations d’avant pandémie. Une telle approche crée des écarts de plus en plus importants entre les coûts estimés et les coûts réels, notamment dans les projets de rénovation, de modernisation d’infrastructures, ou de construction d’immeubles à vocation sociale ou institutionnelle.
Contrairement à l’Alberta ou à la Colombie-Britannique, qui subissent les contrecoups directs de catastrophes climatiques, le Québec fait face à une hausse plus insidieuse, répartie sur plusieurs composantes (cuisines, salles de bains, revêtements extérieurs) qui deviennent critiques dans les projets municipaux.
L’effet d’amplification vient aussi du marché de l’assurance : plusieurs bâtiments publics et semi-publics sont aujourd’hui sous-assurés, exposant les organismes à des pertes importantes en cas de sinistre.
Dans ce contexte, il devient impératif pour les décideurs québécois de réviser les barèmes, actualiser les valeurs assurées, et ajuster les prévisions de dépenses en tenant compte des tendances réelles du marché.
Composantes critiques : une pression cachée sur les appels d’offres publics
Les décideurs municipaux connaissent bien les hausses générales, mais sous-estiment souvent l’impact des hausses spécifiques par poste de dépense. En 2025, selon Verisk, les plus fortes hausses nationales proviennent des toitures (+4,9 %), des salles de bain (+4,5 %) et des revêtements extérieurs (+4,3 %).
Au Québec, ces postes sont particulièrement coûteux pour les écoles, CHSLD et bâtiments municipaux anciens, souvent visés par les plans de rénovation. Ces composantes sont aussi les premières à être ciblées par les soumissionnaires, créant une surenchère indirecte dans les appels d’offres.
À long terme, cette dynamique oblige les organisations à réviser leurs clauses contractuelles, intégrer des mécanismes d’ajustement automatique des prix, et renforcer la planification budgétaire.
En plus des matériaux, la main-d’œuvre spécialisée reste rare dans certaines régions. Cela accentue le délai des travaux et les dépassements de coûts, surtout dans les régions intermédiaires ou éloignées.
À retenir — Actions à poser :
-
Prioriser les évaluations détaillées par composante (toiture, salle de bain, etc.)
-
Réviser les estimations de coûts dans les appels d’offres
-
Prévoir des clauses d’indexation dans les contrats
-
Intégrer des marges de sécurité budgétaire plus élevées
Sous-assurance des bâtiments publics : un risque croissant
Le sous-financement de la reconstruction est une problématique de plus en plus documentée. Selon Verisk, la valeur assurée des immeubles publics est souvent basée sur des données obsolètes, datant d’avant la pandémie ou des ajustements climatiques récents.
Depuis 2020, les coûts au pied carré ont augmenté de 29,1 % au Canada, mais peu d’organismes publics ont ajusté leurs valeurs assurées à la hauteur de cette réalité. En cas de sinistre, l’écart entre la valeur assurée et le coût réel de reconstruction pourrait entraîner d’importants déficits, voire des reports ou annulations de projets.
Au Québec, plus de 62 % des immeubles scolaires ont plus de 40 ans (ISQ, 2023). Ce parc vieillissant est particulièrement vulnérable aux sinistres (dégâts d’eau, bris mécaniques, etc.). Un ajustement rapide des couvertures devient stratégique.
De plus, les assureurs eux-mêmes revoient leurs modèles de risque, en intégrant davantage d’analytique prédictive et de modèles de tarification dynamique, rendant les contrats plus restrictifs.
À retenir — Actions à poser :
-
Auditer annuellement les valeurs assurées des actifs
-
Prioriser les bâtiments anciens ou à vocation sociale
-
Intégrer les coûts réels de reconstruction dans les polices
-
Former les équipes RH et TI sur l’actualisation des données
Stabilité apparente au Québec : un piège budgétaire à long terme
Bien que le Québec affiche une hausse de coûts légèrement inférieure à la moyenne nationale en 2025, cette stabilité est trompeuse. D’une part, l’augmentation de 12,9 % en 3 ans pèse déjà lourd dans les bilans ; d’autre part, cette croissance est linéaire, mais continue, et les budgets ne suivent pas.
En particulier, les projets municipaux de 1 000 à 5 000 pieds carrés subissent des augmentations plus rapides, notamment à l’Île-du-Prince-Édouard et en Atlantique, ce qui crée des tensions comparatives sur les prix régionaux, y compris au Québec.
Les organismes publics qui travaillent avec des estimations vieillies de plus de 2 ans risquent de devoir renégocier ou annuler des projets. Cela affecte non seulement l’exécution des mandats, mais aussi la confiance du public et des partenaires.
Un plan de rattrapage est donc nécessaire pour rétablir la synchronisation entre la réalité du marché, les enveloppes budgétaires, et les coûts prévisionnels.
À retenir — Actions à poser :
-
Réviser les bases de calcul de tous les projets > 1 000 pi²
-
Évaluer la faisabilité régionale de chaque chantier (coût/matériaux disponibles)
-
Prioriser les projets critiques avec un facteur d’urgence ajusté
-
Éviter les comparaisons interprovinciales non contextualisées
Conclusion
Le coût en construction en 2025 évolue dans une zone de hausses lentes mais persistantes. Pour les institutions publiques québécoises, cette trajectoire présente un double défi : gérer l’inflation spécifique des composantes, et adapter leurs pratiques administratives au contexte actuel.
Le Québec ne fait pas exception à cette tendance, même s’il semble moins touché que l’Ouest canadien. C’est d’ailleurs ce qui rend l’ajustement plus délicat : l’illusion de stabilité masque une augmentation réelle de près de 13 % en trois ans. C’est suffisant pour déséquilibrer un budget municipal, provoquer une sous-assurance majeure ou retarder un projet d’infrastructure essentiel.
Le moment est venu pour les directions générales, les ressources humaines et les services techniques de repenser leur stratégie d’évaluation des actifs et de planification des projets. Cela implique de se doter d’outils modernes, d’accéder à des données fiables (comme celles de Verisk), et d’ajuster les mécanismes internes (clauses contractuelles, appels d’offres, etc.).
À défaut, c’est la pérennité des infrastructures publiques — et leur financement — qui sera compromise. Ce n’est pas la prochaine catastrophe climatique qui mettra les organisations en difficulté : ce sera leur propre retard d’adaptation.
Le signal est clair : mieux vaut ajuster aujourd’hui que reconstruire à perte demain.
Références officielles
-
Statistique Canada — Indice des prix de la construction de bâtiments (SDDS 2317)
-
Verisk Canada — Rapport Q1 2025 Reconstruction Cost
-
Institut de la statistique du Québec — Infrastructures scolaires et bâtiments publics
Tendances en construction